Chercheur associé au Parc naturel régional du Perche depuis 2011, en charge de l'étude et de la valorisation du patrimoine bâti.
- enquête thématique régionale, architecture rurale du Parc naturel régional du Perche
- (c) Région Normandie - Inventaire général
- (c) Parc naturel régional du Perche
Dossier non géolocalisé
-
Dénominationsmaison, ferme
-
Aires d'étudesParc naturel régional du Perche
-
Adresse
- Commune : Longny-au-Perche
Parmi les 157 édifices ruraux repérés (108 fermes, 26 maisons et 23 bordages), 14 ont été sélectionnés pour l’étude (soit 12 fermes et 2 maisons de maître) et font l’objet de 13 dossiers (à la Linardière, l’ancienne ferme et la maison de maître sont regroupées en un seul dossier) ; quatre dossiers d’ensemble de type « écart » regroupe les maisons et les fermes de certains hameaux.
Au sein d'un plateau anciennement bocager, à dominante céréalière depuis les années 1980, l´habitat se trouve dispersé sur l´ensemble du territoire communal, à l’exclusion des zones forestières essentiellement à l’est (forêt de Longny, Bois du Pissot, Bois de la Heslière) et en bordure ouest, le long de la Commeauche qui marque la limite orientale du massif de Réno-Valdieu. La commune compte environ 70 lieux-dits dont une cinquantaine de fermes, maisons et moulins isolés et une vingtaine de hameaux dont les plus importants sont le Bois Boulay, la Barbinière, Bizouieau, la Chauvellière, les Yvieux et le Val du Tellier.

Une terre de polyculture et d’élevage
Le plateau et les fonds de vallées de Longny et, plus généralement, du Perche sont traditionnellement exploités en polyculture et en élevage - les herbages proches des cours d’eau étant pâturés par des chevaux percherons (même si aucune ferme d’élevage n’est référencée aux stud-book) utilisés comme chevaux de trait et trotteurs, et par des troupeaux de vaches produisant lait et viande. Les hauteurs de plateau apparaissent plus propices à la culture de céréales. Chaque ferme dispose d’un toit à porcs (un ou deux porcs élevés par an), d’un poulailler et de clapiers à lapin. Les plus grandes, à vocation céréalière (Optain, Beauvais, etc.), possèdent au 19e siècle, voire avant, un troupeau de moutons de 100 à 200 têtes passant l’hiver dans la bergerie. Au printemps, les moutons pâturaient dans les prés et les guérets puis, après la moisson, étaient installés dans des parcs à moutons dans les chaumes. Formés de claies assemblées en carré autour de la cabane-roulotte servant de logis au berger, les parcs étaient régulièrement déplacés. Les moutons désherbaient les champs et fumaient les terres. Comme dans tout ce secteur nord du Perche, le territoire de Longny s’est spécialisé, dès le 2e quart du 19e siècle, dans l’élevage bovin destiné notamment à alimenter le marché parisien, ce qui explique le nombre important de foires aux bestiaux de Longny.
Concernant les pratiques culturales, l’assolement quadriennal était mis en œuvre au 19e siècle et ce, jusque dans l'entre-deux-guerres où émerge la seconde révolution agricole, afin d’assurer sur place la production de l’alimentation des animaux de la ferme. Suivant les années, étaient cultivés racine, blé, avoine et fourrage vert (luzerne, trèfle, sainfoin). Le blé était privilégié sur les terres argileuses, amendées par des chaulages et des marnages, l’apport de calcaire permettant la culture de légumineuses contribuant à l’enrichissement du sol. L’avoine, peu exigeante sur la nature du sol, occupait une place importante dans les cultures et constituait l’aliment énergétique des chevaux. Les terres pauvres, maigres ou légères étaient cultivées en seigle. Chaque ferme en cultivait une parcelle : sa paille, haute, droite et souple, servait pour la fabrication des liens pour la moisson. Une petite partie des récoltes était vendue au marché de Longny, sous les halles, ou stockée dans la graineterie jouxtant l’ancienne école de filles, rue Sébastopol (n°4 de l’actuelle rue Eugène Cordier). Après la Seconde Guerre mondiale, la mécanisation et l’arrivée des intrants chimiques entraînent une augmentation des récoltes et la construction de la coopérative agricole de Longny, à la sortie du bourg, sur la route de Bizou, non loin de la Fenderie.
Définition des familles d’édifices
Il est parfois difficile de distinguer la ferme de la maison du fait des remaniements successifs et de l’abandon, parfois ancien, de l’activité agricole. Pour les fermes, l’exploitation agricole – en polyculture et élevage jusqu’à l’après-guerre – nécessite la présence de dépendances servant, soit à abriter le bétail, soit à stocker le fourrage et les céréales récoltées. Le commanditaire (ou le locataire) de la ferme tire son revenu de la vente de sa production agricole. La maison se distingue par l’absence de dépendance agricole significative. Son occupant tire son revenu d’une (ou plusieurs) autre(s) activité(s). Il peut être journalier (louant ponctuellement ses bras aux fermes proches lors des labours, aux « usines » métallurgiques du secteur et/ou aux exploitants forestiers) ou artisan (activité liée au bois (bûcheron, scieur de long, fendeur, charbonnier, sabotier, etc.), à la construction (maçon, charpentier, menuisier, etc.) et à la transformation du chanvre (fileuse, tisserand)). Le bordage constitue l’échelon intermédiaire entre la maison et la ferme. Sous l’Ancien Régime, et tout au long du 19e siècle, le bordager est un paysan, indépendant ou locataire, qui pratique une agriculture de subsistance. Il ne dispose que d'une ou deux dépendances agricoles, lui permettant de posséder des poules, un cochon, une ou deux vaches et parfois un cheval.

Repères historiques
Les maisons rurales se situent généralement au sein des hameaux les plus importants (le Bois Boulay, la Barbinière, Bizouieau, la Chauvellière, les Yvieux, le Val du Tellier), ainsi que dans des écarts moindres, proches (ou au sein) des sites industriels locaux (Rainville, Beaumont, la Poêlerie, la Fenderie) ou de massifs forestiers (les Loges des Gars). Neuf maisons pourraient dater du 18e siècle comme tendent à le montrer plusieurs caractéristiques architecturales : la pente de toit, plus faible que pour les édifices antérieurs mais plus forte qu’au 19e siècle, les murs maçonnés en moellons de silex enduits d’une épaisseur comprise entre 45 et 55 cm, l’emploi d’une brique ou d’une pierre de taille de grès roussard non calibrée pour les encadrements d’ouvertures et les chaînages d’angle, etc. Les autres maisons datent du 19e siècle, parfois construites (ou reconstruites) après le passage du géomètre du premier cadastre daté de 1830.
Les bordages suivent la même implantation que les maisons rurales, au sein de hameaux de moyenne à grande importance. Trois édifices pourraient dater du 17e siècle (à la Fuserie, au Chesnay et au Bois Boulay) comme tend à l’indiquer leur volume général, leur forte pente de toit et la présence de pan de bois, parfois à l’état de vestige. Huit bordages pourraient dater du 18e siècle (leurs caractéristiques architecturales étant similaires à celles des maisons de la même période). On les retrouve notamment à la Barbinière, au Val du Tellier, à Bizouieau ou à l’Étang Chiot. Trois datent certainement de la fin du 18e siècle ou du début du siècle suivant (au Pissot). Il a été comptabilisé neuf bordages construits, ou reconstruits, au 19e siècle et au début du siècle suivant.
Seules deux fermes se situent dans le bourg, rue du Pont Rouge et à la sortie sud du village, rue de la Forge. La première possède des bâtiments agricoles du 19e siècle, très remaniés au 3e quart du 20e siècle. Construite au tournant du 20e siècle, la seconde apparaît plus homogène. Les autres fermes sont isolées pour 35 d’entre elles soit environ le tiers du corpus, ou implantées au sein des nombreux hameaux de petite et moyenne importance. Les fermes isolées se répartissent sur l’ensemble du plateau, en dehors des zones forestières, souvent en bordure, surplombant les vallons et vallées. On constate une forte concentration de fermes de dimensions importantes, dès les 17e et 18e siècles, dans un rayon d’un kilomètre autour du bourg et surtout au nord. Créées par les barons de Longny, elles ont été agrandies aux 18e et 19e siècles en lien avec le développement du bourg. Les fermes les plus anciennes, remontent au 16e siècle pour au moins 3 d’entre elles (les Bottereaux, la Porte et Beauvais) qui conservent des éléments significatifs de cette époque. 16 fermes pourraient dater du 17e siècle, période durant laquelle on construit majoritairement en pan de bois comme à la Brière, à la Grande Moisière ou au Buat. Près de la moitié des fermes (49 au total) date du 18e siècle, correspondant probablement pour nombre d’entre elles à des reconstructions in situ. 36 fermes datent du 19e siècle et 4 de la première moitié du 20e siècle. Certaines fermes ont connu un développement industriel dans la seconde moitié du 20e siècle avec la construction de hangars et de stabulations.
Plusieurs dates, chronogrammes portés sur l’œuvre ou mentionnés dans des matrices cadastrales, attestant de constructions ou de remaniements ont été relevées : 17[...], 1772, 1788, 1826, 1830, 1833, 1838, 1839, 1841, 1842 (2 fois), 1847, 1849, 1851, 1852, 1853 (3 fois)1854, 1855, 1856, 1858, 1859 (2 fois), 1860, 1861, 1862, 1863, 1865, 1868, 1870, 1874, 1879, 1886, 1890, 1892, 1898, 1900, 1934, 1947, 1951, 1952, 1964.
Commanditaires
Sous l’Ancien Régime, période d’intense construction de fermes et de maisons, le territoire paroissial est divisé en fiefs dépendant en grande partie de la baronnie de Longny. Quelques petites seigneuries conservent leur indépendance (Linardière) ou sont rattachées tardivement à la baronnie de Longny (les Bottereaux, la Bretèche, la Heslière). Sur la frange sud-est, certains fiefs dépendent de la seigneurie de Feillet sur la paroisse voisine du Mage (Bizouieau, la Véronnière). A l’opposé, au nord-ouest, d’autres fiefs sont dans la zone d’influence de de la Chartreuse du Val-Dieu, sur la paroisse voisine de Feings. Le monastère possède quelques fermes et bordages, notamment au Bois Boulay. Implanté en 1633 au bourg de Longny, le prieuré Saint-Sauveur possède la ferme du Gand Verdereau. Les seigneurs, ecclésiastiques ou laïcs, sont vraisemblablement à l’initiative de la construction ou de la reconstruction de nombreuses fermes aux 17e et 18e siècles. Consécutivement à la nationalisation des biens monastiques à la Révolution et à la division du domaine de Longny au milieu du 19e siècle, d’importants domaines agricoles se développent au 19e siècle, notamment à Optain, aux Réhardières et à la Barre.
Structure et composition d´ensemble
Parmi les 108 fermes repérées, seules trois disposent d’une cour fermée par des murets de clôture (à la Barbinière et à la Fuserie). Il faut y ajouter les fermes de la Bretèche, de Bel-Air et de la Grande Moisière dont la cour se ferme dans la 2de moitié du 19e siècle. Aucune ferme ne dispose d’un logis indépendant, qui ne soit pas attenant aux dépendances agricoles. Près d’un tiers des fermes, soit 32 unités, sont de type « bloc à terre » simple, un bâtiment abritant sous un même toit le logis et les dépendances. La laiterie est souvent placée en façade postérieure, orientée au nord en général, et la voûte du four se situe le plus souvent sous un appentis contre le pignon et accolée au toit à porcs. La majorité des fermes dispose d’au moins deux ou trois bâtiments (jusqu’à cinq ou six pour les plus grandes) se faisant face ou répartis en « L », en « U » ou en « O » autour d’une cour ouverte. Le bâtiment principal abrite, sous un même toit ou dans des corps de bâtiments juxtaposés, dont les volumes peuvent varier, le logis, le cellier, l’écurie, l’étable et le toit à porcs. En face, ou perpendiculaire au premier, le second bâtiment sert de remise ou de grange, étable, écurie ou bergerie.
Le logis des fermes est généralement en rez-de-chaussée (96), plus rarement surélevé (6). Seuls six logis de ferme disposent d’un étage carré à la Porte, Optain, la Gaudinière, la Cormière et aux Petites Loges. Dans des secteurs, très localisés, marqués par un relief plus ou moins pentu, les élévations compensent les dénivelés par un étage de soubassement ou un rez-de-chaussée surélevé, voire par l’ajout d’un escalier extérieur. Tel est le cas notamment à l’Étang Chiot.

A l’instar des logis de ferme, les maisons et les bordages sont majoritairement en rez-de-chaussée, surélevé pour 6 d’entre eux. Seulement quatre maisons disposent d’un étage carré, à la Forge, à la Linardière, à la Bâtisse et au Val du Tellier (les trois premières étant des maisons de maître, la dernière étant initialement une maison élémentaire rehaussée tardivement). Les maisons élémentaires et les bordages disposent d’une ou deux pièces à vivre juxtaposées, la salle (avec cheminée) et une chambre (parfois sans feu). Les dispositions des maisons de notable, construites au 17e et au 18e siècles, sont comparables à celles du bourg de Longny : plan symétrique d’inspiration classique, travées d’ouvertures, entrée centrale donnant sur l’escalier, etc.
Matériaux et mises en œuvre
Pour les bâtiments les plus anciens, les murs sont en pan de bois hourdé de torchis. Cette structure, qui peut ne concerner que les murs gouttereaux, repose sur un solin maçonné en moellons de silex. Le torchis est protégé par un enduit de chaux et de sable local.

La nature du sous-sol, qui varie selon les secteurs du territoire communal, donne des mises en œuvre parfois très spécifiques. Si le silex, obtenu en dépierrant les champs, est largement employé sous forme de moellons dans les parements des murs, les grès prédominent localement : le roussard, un grès ferrugineux parfois accompagné de grison (poudingue), au nord-ouest et au nord, un grès blond, localement appelé pierre de sable, notamment dans le secteur de la Heslière où le sable est toujours exploité au sud et au sud-est. Ce dernier, employé surtout au 18e et au 19e siècles dans le bâti rural, a pour particularité d’être mise en œuvre sans chaînage d’angle et parfois sans encadrement d’ouverture (réduit à un linteau en bois). À cette exception près, la plupart des constructions rurales disposent de chaînes d’angle et d’encadrements de baies, dont la partie basse, exposée aux remontées d’humidité, est en pierre de taille de roussard, et parfois de grison. Le calcaire, extrait dans le bassin de Mortagne ou dans la vallée de l’Huisne, plus au sud, est également employé dans les constructions, sous forme de pierre de taille (encadrements des baies, chaînages d´angle, corniches et jambes harpées).



La brique, tout comme la tuile plate, se généralise dans les constructions rurales dès le 18e siècle. Il semble cependant qu’elle soit présente antérieurement, dès la 2de moitié du 17e siècle, dans certaines constructions dépendant de la baronnie de Longny comme à la ferme de la Barre. Elle est employée dans les chaînages d’angle, les encadrements d’ouvertures, les bandeaux séparant parfois les niveaux d’élévation, les corniches et les souches de cheminée. Non calibrée jusqu’au milieu du 19e siècle, période à laquelle la maîtrise des cuissons permet la création de modules bien définis, la brique est cuite dans les trois tuileries-briqueteries implantées sur le territoire communal : au bourg, où se trouve la plus ancienne attestée en 1730, à la Tuilerie de la Mare Rouge, construite en 1810, et à la Petite Moisière, construite entre 1812 et 1831.
Les murs sont traditionnellement couverts d'un enduit plein à base de chaux aérienne et de sable local donnant une palette de couleur variant du jaune à l’ocre. Ces sables colorés sont extraits à Longny, de la carrière de la Heslière depuis les années 1990. Si l'enduit à pierre vue est encore prisé aujourd'hui, il se révèle inadapté pour protéger efficacement les moellons, parfois en calcaire, friable et gélif.
Couvertures
Les toits des maisons et des fermes sont généralement à longs pans et plus rarement à croupes, observées notamment à la Bâtisse, à la Bretèche, à la Givardière et à la Sauvagère. Les couvertures sont majoritairement en tuile plate cuite, à l’instar des briques, dans trois tuileries-briqueteries de Longny ou celles des communes voisines.
Certains bâtiments agricoles sont couverts en tuile mécanique (la Bretèche, la Brisardière, la Détourbe) ou en tôle ondulée (la Chauvellière, la Marchandière). L’usage de l’ardoise se généralise à partir de 1850 au bourg et sur quelques fermes et maisons en écart (la Gilberdière, la Massière, le Port Mahon).
Conclusion
L´architecture rurale de la commune déléguée de Longny-au-Perche a connu de nombreux remaniements au gré de l´évolution des manières d'habiter et de la mécanisation de l'agriculture. La diversité du bâti de la commune, tant au niveau des usages que des matériaux de construction, reflète une activité agricole modeste, souvent exercée en complément d’un artisanat lié au travail du chanvre et à l’exploitation de la forêt. L'abondance des reconstructions, des remaniements et des extensions de dépendances agricoles témoigne cependant du développement de l'agriculture qui connaît son apogée entre le milieu du 19e siècle et le premier quart du 20e siècle.
La Barre, la Bâtisse, Beauvais, le Bois Boulay, les Bottereaux, la Bretèche, la Brière, la Gaudinière, la Givardière, le Grand Verdereau, la Grande Moisière, la Heslière, la Linardière et le Val du Tellier conservent les éléments les plus significatifs du bâti rural de la commune.

- (c) Région Normandie - Inventaire général
- (c) Parc naturel régional du Perche

- (c) Région Normandie - Inventaire général
- (c) Parc naturel régional du Perche

- (c) Région Normandie - Inventaire général
- (c) Parc naturel régional du Perche

- (c) Région Normandie - Inventaire général
- (c) Parc naturel régional du Perche

- (c) Région Normandie - Inventaire général
- (c) Parc naturel régional du Perche

- (c) Région Normandie - Inventaire général
- (c) Parc naturel régional du Perche

- (c) Région Normandie - Inventaire général
- (c) Parc naturel régional du Perche

- (c) Région Normandie - Inventaire général
- (c) Parc naturel régional du Perche

- (c) Région Normandie - Inventaire général
- (c) Parc naturel régional du Perche

- (c) Région Normandie - Inventaire général
- (c) Parc naturel régional du Perche
Bibliographie
-
FISCHER, Roger. Les maisons paysannes du Perche. Paris : Eyrolles, Maisons paysannes de France, 1994.
-
MAILLARD, Florent (dir.), BILLAT, Hélène (dir.), MERRET, Patrick (phot.), LAMORLETTE, Vanessa (phot.) . Architectures du Perche. Lyon : Lieux-dits, 2018. 192 p.
Périodiques
-
NEVEU, Lucien. Longny-au-Perche – 1900-1914, tome II, la campagne. Cahiers Percherons, 1975, n°46.
Chercheur associé au Parc naturel régional du Perche depuis 2011, en charge de l'étude et de la valorisation du patrimoine bâti.
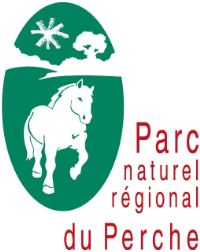





Chercheur associé au Parc naturel régional du Perche depuis 2011, en charge de l'étude et de la valorisation du patrimoine bâti.